jeudi, 07 mai 2020
Mise au poing : Scènes de boxe d'Elie Robert-Nicoud

Nul besoin d’avoir enfilé des gants et monté sur un ring pour apprécier ce petit et dense ouvrage. Avec verve et simplicité, Elie Robert-Nicoud (dont le père était boxeur professionnel devenu par la suite peintre), ne se contente pas de décrire la boxe comme un sport parmi tant d’autres, non, mais de raconter, force anecdotes à l’appui, la boxe comme un monde. Et pas n’importe lequel.
Un monde souvent sale et puant comme Stillman’s Gym, la salle mythique de l’université de la 8e Avenue de New-York, jamais nettoyée, empestant la poussière, la sueur et la fumée des cigares. Un monde où les boxeurs sont d’anciens voyous ayant fait leurs armes dans les bagarres de rue, les gangs et les vols à l’arraché (comme Mike Tyson dans le ghetto de Brownsville où il a grandit), voire de véritable gangsters sous la protection des parrains locaux (Al Capone qui embrasse Mickey Cohen sur les deux joues). Un monde où les pères refusent catégoriquement que leurs fils les suivent sur le ring mais finissent par les entraîner, les pousser à bout, les haïr même et pleurer dans leurs bras comme chez les Mayweather père et fils ou comme Joe et Enzo Calzaghe. Un monde qui fascine autant les jazzmen (Miles Davis, Willie Smith) que les cinéastes (King Vidor, Ed Bland, Ralph Nelson, Robert Wise, Scorsese, Michael Mann). Un monde de déracinés et d’immigrés accentuant les tensions ethniques par racisme ou accroche commerciale (« En Amérique, il y a eu les Irlandais, puis les Juifs, puis les Italiens, puis les Noirs, puis les Latinos et aujourd’hui les Slaves. Et c’est la même chose en France, les Juifs, les Arabes, les Gitans, les Italiens et les pauvres des villes… »).
Un monde où nombre de combats sont truqués par la pègre (ceux de Mohamed Ali contre Sonny Liston, gangster notoire) et où les boxeurs sont volés par leur manager (Don King étant l’archétype de l’escroc bariolé ayant commencé sa carrière par tuer un homme dans un caniveau). Un monde principalement masculin mais qui a vu naître une puncheuse exceptionnelle : Ann Wolfe, orpheline à 18 ans, dealer, SDF et championne du monde dans cinq catégories à la fois. Un monde où l’on peut tuer son adversaire d’un crochet à la mâchoire ou d’un uppercut dans l’estomac et dont le fantôme revient hanter le ring des années durant comme Max Baer dévoré par les morts de Frankie Campbell et d’Ernie Schaaf. Un monde d’adversité animale dans lequel les vainqueurs et les perdants se mélangent au sein de la même légende : Jake La Motta et Sugar Ray Robinson, Schmeling et Joe Louis, Micky Ward et Arturo Gatti, Ali et Joe Frazier. Un monde peuplés de techniciens hors-pair, combinant grâce et force brute, mais aussi un monde plus vaste et souterrain peuplé de seconds couteaux, parfois alcooliques et drogués, aux visages ravagés et à l’esprit en miette. Un monde sans pitié, écœurant mais dont, par une fascination masochiste et enivrante, il est impossible de se libérer.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
22:28 Publié dans Littérature | Tags : max baer, jake la motta, sugar ray robinson, ann wolfe, noble art, mohamed ali, sonny liston, joe et enzo calzaghe, mike tyson, al capone, mise au poing, scènes de boxe, elie robert-nicoud, le comptoir, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 08 avril 2020
Stéphane Duval : « Le Lézard Noir a œuvré pour une meilleure reconnaissance de la BD alternative japonaise »

Article initialement paru sur Le Comptoir
C’est en 2004 que Stéphane Duval fonde la maison d’édition Le Lézard Noir (référence au roman éponyme d’Edogawa Ranpo) spécialisée dans la bande-dessinée japonaise dite « décadente » (buraiha), le romantisme noir et l’Ero guro (érotique grotesque). Diversifiant sa ligne éditoriale, le catalogue compte désormais plus de soixante titres, mêlant les mangas horrifiques de Suehiro Maruo, Kazuo Umezu ou Makoto Aida, aux romans graphiques d’avant-garde (Yaro Abe, Minetaro Mochizuki, Akino Kondoh), en passant par les ouvrages pour enfants et les livres d’architectures et de photographies japonaises (Atsushi Sakai, Yasuji Watanabe).
Le Comptoir : Ces dernières années, les ouvrages de votre maison d’édition ont obtenus une certaine reconnaissance : Prix Asie de la Critique ACBD pour Chiisakobé de Minetarô Mochizuki en 2016 et pour La Cantine de Minuit de Yaro Abe en 2017 ; Prix du patrimoine au Festival d’Angoulême pour Je suis Shingo Tome 1 de Kazuo Umezu en 2018. Ces récompenses s’inscrivent-elles, selon vous, dans la légitimation grandissante du manga (notamment pour adulte) en France ?
 Stéphane Duval : Il y a effectivement eu une bascule auprès du grand public et des médias ces dernières années. Le manga était jusqu’à peu considéré comme un bien de consommation mainstream, plutôt pour un lectorat ado et était boudé par une partie du public. Mis à part peut-être Akira (1982) de Katsuhiro Ōtomo qui était un ovni dans le paysage graphique. Je pense que le décloisonnement est venu par la publication de mangas dit d’auteurs, Gekiga (« dessins dramatiques ») et labélisés « roman graphiques ». Il y a eu L’Homme sans talent (1991) publié par la maison d’édition Ego Comme X et les mangas de Shigeru Mizuki ou Yoshihiro Tatsumi édité par Cornélius qui ont reçu des distinctions à Angoulême.
Stéphane Duval : Il y a effectivement eu une bascule auprès du grand public et des médias ces dernières années. Le manga était jusqu’à peu considéré comme un bien de consommation mainstream, plutôt pour un lectorat ado et était boudé par une partie du public. Mis à part peut-être Akira (1982) de Katsuhiro Ōtomo qui était un ovni dans le paysage graphique. Je pense que le décloisonnement est venu par la publication de mangas dit d’auteurs, Gekiga (« dessins dramatiques ») et labélisés « roman graphiques ». Il y a eu L’Homme sans talent (1991) publié par la maison d’édition Ego Comme X et les mangas de Shigeru Mizuki ou Yoshihiro Tatsumi édité par Cornélius qui ont reçu des distinctions à Angoulême.
En parallèle des éditeurs comme IMHO ou Le Lézard Noir ont œuvré pour une meilleure reconnaissance de la BD alternative japonaise en construisant des catalogues exigeants, mêlant patrimoine et mangas plus expérimentaux. La mise en avant du manga par des belles expositions au Festival d’Angoulême a également contribué à une meilleure reconnaissance de la bande dessinée japonaise. Au Lézard Noir j’ai progressivement ouvert le catalogue vers des titres plus grand public et littéraires en recherchant des mangas contemporains plus en phase avec ce que je connaissais du Japon et de sa culture. Les séries Le Vagabond de Tokyo, Chiisakobé et La Cantine de Minuit avec leurs thématiques plus sociétales et contemporaines en sont les exemples les plus marquants.
14:03 Publié dans Littérature | Tags : stéphane duval, le lézard noir, bd alternative japonaise, manga, le comptoir, sylvain métafiot, kazuo umezu, sade, bataille, ero guro, le vagabond de tokyo, chiisakobé, la cantine de minuit, suehiro maruo | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 16 mars 2020
Labyrinthe mental : Dédales de Charles Burns

Attablé dans une cuisine, à l’écart de la fête battant son plein, Brian, un jeune homme dessine une étrange créature (« alien compressé« , poulpe astral) sur un carnet en observant, hébété, son reflet déformé dans le grille-pain posé devant lui. « Ça m’a pris du temps avant de me rendre compte que j’étais en train de dessiner un autoportrait« , comprend-t-il après un temps de latence hypnotique avant que Laurie vienne le rejoindre et trouble son univers psychique.
Dédales est sans conteste l’œuvre la plus autobiographique de Charles Burns. L’histoire d’un jeune homme enfermé en lui-même, déphasé, ayant du mal à communiquer avec les autres et n’ayant que le désir d’être compris à travers ses dessins ou les images de films fantastiques. Brian crée ainsi des petits court-métrages d’horreur en Super 8 avec son ami Jimmy (« le film parle de tous les trucs tordus qui se passent dans ma tête« ). Dans son enfance, Burns n’était pas indifférent à ce genre de production vidéos mises en avant dans Monster Magazine. Ce n’est donc pas un hasard si Brian emmène Laurie voir L’Invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel au cinéma et si, profondément ému, il verse des larmes durant la projection. Car comment être normal dans une société dépourvue de sens ? Ne sommes-nous pas comme les extraterrestres du film, possédant une forme humaine mais « privés de sentiments et d’espoir » ?
Charles Burns est coutumier du fait de nous entraîner dans de sombres terriers débouchant sur des univers cauchemardesques mettant à nu le caractère faussement familier de l’Amérique des années 50 / 60. Que l’on songe à la trilogie Toxic (mélange improbable entre Tintin et David Lynch) où entraîné – par un chat noir faisant office de lapin blanc – derrière la cloison d’une chambre se trouve un monde abject et fantastique reflétant les tourments psychologiques de son héros. Ou Black Hole dans lequel une sorte de malédiction mi-biologique mi-surnaturelle infecte monstrueusement les adolescents après chaque rapport sexuel (un thème qui sera repris dans le terrifiant film It Follows de David Robert Mitchell). Poursuivant ainsi son exploration du mal-être adolescent et du sentiment de perte (des personnes que l’on aime, des objets d’enfance, des lieux et leur histoire) nul doute que la suite de Dédales nous emmènera encore plus loin dans les recoins ténébreux de la quête d’identité.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
15:07 Publié dans Littérature | Tags : labyrinthe mental, dédales, charles burns, sylvain métafiot, le comptoir, bd | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 24 février 2020
Métaphysique de la technique : L’Homme et la machine de Nicolas Berdiaeff
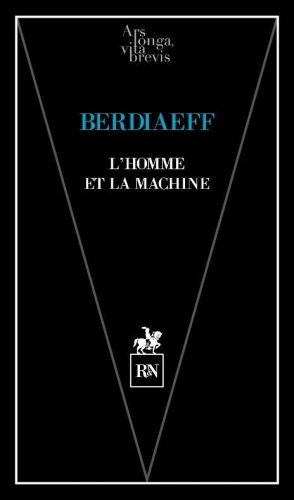 Trois ans après avoir fait (re)paraître L’Homme et la technique d’Oswald Spengler – décryptant ce qu’il appelle la « culture Faustienne » de l’Occident – les éditions R&N publient un nouveau petit essai critique sur la modernité de la première moitié du XXe siècle : L’Homme et la machine de Nicolas Berdiaeff (1874-1948). Philosophe existentialiste chrétien, Berdiaeff explore dans ce court essai paru en 1933 les conséquences de l’apparition de la machine, « la plus grande révolution voire la plus terrible de toute l’histoire humaine ».
Trois ans après avoir fait (re)paraître L’Homme et la technique d’Oswald Spengler – décryptant ce qu’il appelle la « culture Faustienne » de l’Occident – les éditions R&N publient un nouveau petit essai critique sur la modernité de la première moitié du XXe siècle : L’Homme et la machine de Nicolas Berdiaeff (1874-1948). Philosophe existentialiste chrétien, Berdiaeff explore dans ce court essai paru en 1933 les conséquences de l’apparition de la machine, « la plus grande révolution voire la plus terrible de toute l’histoire humaine ».
Analysant le concept de la technique sous un angle sociologique et métaphysique, Berdiaeff montre que ce fait « tragique » bouleverse notre culture tant matériellement qu’économiquement mais aussi spirituellement : « Deux éléments coexistent toujours dans la culture : l’élément technique et l’élément organique ; et c’est la victoire définitive du premier sur le second marque la dégénérescence de la culture en quelque chose qui ne l’est plus ». Comme le note justement Edouard Schaelchli dans sa préface : « loin de se laisser comprendre comme un simple phénomène matériel, [le phénomène technique] s’impose à l’esprit et détermine une attitude à son égard qui s’apparente plus qu’à une forme d’aliénation, à une véritable forme d’adoration, d’idolâtrie. » Difficile de lui donner tort quand on voit le culte que certains de nos contemporains vouent à leur smartphone au point de ressentir une angoisse panique en cas de perte (« j’ai toute ma vie dedans », suffoquent-ils).
Ayant fait sa révolution industrielle au XIXe siècle, la machine poursuivit ainsi son inexorable marche en avant au siècle suivant portée par les hourras des progressistes qui semblaient avoir oubliés cette mise en garde de Victor Hugo : « Sans cesse le progrès, roue au double engrenage, Fait marcher quelque chose en écrasant quelqu’un. » Plus proche de Nietzsche, Schelling ou Kierkegaard, Berdiaeff ne dit pas autre chose lorsqu’il décrit la révolte de la créature face à une force qui peut, par les armes, détruire toute l’humanité : « L’esprit prométhéen chez l’homme ne parvient pas à maîtriser la technique qu’il a lui-même engendrée, il ne peut venir à bout de ces énergies nouvelles qu’il a déchaînées. » Pour autant, le philosophe russe n’idéalise pas un retour au passé (« le passé tel qu’il nous séduit a été affranchi et purifié par notre imagination créatrice de tout ce qu’il comportait de laideur et d’injustices ») et s’il lui est inconcevable de tolérer l’autonomie de la machine, il ne rejette pas tous les torts sur elle : « la machine n’est qu’une projection » du processus global de déshumanisation et la libération de l’homme n’adviendra que par « une conscience qui placera celui-ci au-dessus de la nature et de la société, qui placera l’âme humaine au-dessus de toutes les forces sociales et cosmiques qui devront lui être assujetties ».
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:35 Publié dans Economie, Littérature | Tags : nicolas berdiaeff, le comptoir, sylvain métafiot, l’homme et la machine, éditions r&n | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 04 février 2020
Nietzsche contre la culture barbare
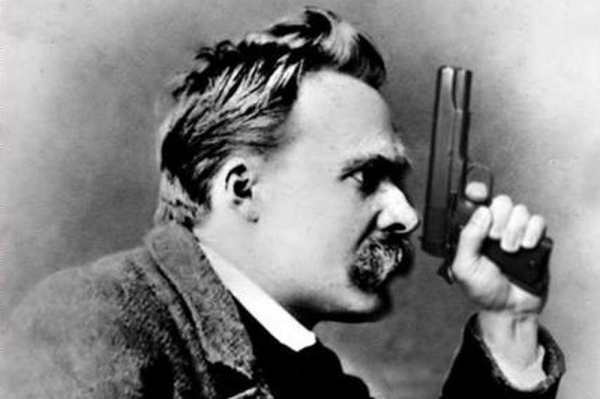
Article initialement paru sur Le Comptoir
Rédigée en 1873 à Bâle, et sous-titré « De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques pour la vie », la « Seconde Considération Inactuelle » fait partie d’une série de quatre traités polémiques dans lesquels le philosophe Friedrich Nietzsche parcourt l’échelle de ses intimités. Il combat une conception purement contemplative du savoir historique conçue comme une fin en soi et découplée de la vie. Pour lui, la connaissance doit permettre de vivre et d’agir.
Ce que son époque considère comme une vertu Nietzsche le considère comme un vice : « nous souffrons tous d’une consomption historique ». Dénonciateur autant que guérisseur, il souhaite ainsi renverser le courant, « contre le temps, et par là même sur le temps en faveur d’un temps à venir ».
« Je déteste tout ce qui ne fait que m’instruire sans augmenter mon activité. » Goethe
Le poids du passé
Le premier paragraphe de la Seconde Considération Inactuelle porte sur l’ambivalence du passé. D’un coté, le passé pèse sur l’homme comme un fardeau invisible parce qu’il s’en souvient, c’est la mémoire qui signe sa prégnance à force de le ruminer. Cette charge nuit à l’homme et l’anéantit car le ressassement empêche l’action : plongés dans nos regrets nous délaissons l’avenir. D’un autre coté, l’oubli est une condition de l’action et du bonheur car agir suppose être dans le présent et orienté vers le futur. Dans ce cas, le passé peut peser comme un acquis.
21:37 Publié dans Littérature, Politique | Tags : nietzsche contre la culture barbare, le comptoir, sylvain métafiot, seconde considération inactuelle | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 29 décembre 2019
Les Furtifs : Bacurau de Kleber Mendonça Filho

Tout commence dans l’espace. La caméra en orbite autour de la terre se rapproche progressivement du sol, traverse les nuages vers la région du Nordeste du Brésil, suivant enfin la route d’un camion citerne slalomant entre des cercueils éparpillés sur le bitume (signe précurseur que la mort planera tout au long du film, prenant notamment les traits d’un drone aux allures SF des années 50). Perdu dans le Sertaõ, la commune de Bacurau manque d’eau, cette dernière étant retenue par un préfet corrompu et bedonnant qui a engagé des mercenaires américains (menés par le génial Udo Kier) pour soumettre les habitants du village.
D’une grande beauté plastique le troisième film de Kleber Mendonça Filho arrive à mêler génialement les différents genres (post-apocalyptique, chronique sociale, horreur furtive) pour finalement établir une ambiance fiévreuse de western en pleine pampa mélangeant l’archaïque et le futuriste dans une escalade de violence revancharde et implacable. La musique Night qui retentit au mi-temps du film lors d’une scène d’enterrement sous psychotropes ne doit rien au hasard : l’ombre tutélaire de John Carpenter plane sur tout le film (l’école est par ailleurs baptisée « João Carpinteiro »). Menacés de disparition, les habitants du village feront de leur invisibilité une stratégie de défense et de leur propre histoire une faculté d’attaque (le musée faisant office d’armurerie), organisant une fusillade mémorable face à une équipe d’américains puérils et arrogants considérant la guerre comme un jeu. À ce titre, le personnage de Lunga, gangster transgenre et ultraviolent organisant la résistance, fulmine de charisme et aurait mérité davantage de présence à l’écran.
À ce climat poisseux et explosif s’ajoute l’intransigeance du message politique (que l’on devine résonner avec la récente élection du président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro) : face à l’envahissante surveillance technologique et la logique libérale de privatisation de toutes les parcelles de vie sur terre menée par les politicards et les affairistes, Kleber Mendonça Filho montre que la communauté (village, famille, groupe) est une force, qu’elle peut se dissimuler aux yeux des puissants ou bien, si nécessaire, résister avec violence pour préserver ses traditions, sa culture et ses biens communs.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
14:59 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sf, john carpenter, sylvain métafiot, les furtifs, bacurau, kleber mendonça filho | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 25 décembre 2019
Dépression en basse altitude : An Elephant Sitting Still de Hu Bo

Dans une grande ville du nord de la Chine cerclée de fumées charbonneuses, quatre personnages désœuvrés, atteints d’un profond mal-être existentiel se croisent, se frôlent et se confrontent le temps d’une journée brumeuse, dessinant sur la carte de la modernité industrielle les ramifications d’une mélancolie urbaine en noir et bleu.
Radiographiant la détresse collective de tout un pays, Hu Bo déploie une narration étirée (le film dure presque 4h) permettant de symboliser intensément la douleur de ses différents protagonistes. Que ce soit pour fuir la vengeance d’un malfrat, la culpabilité d’un amour interdit, le mépris de sa propre famille ou les remords d’avoir provoqué le suicide d’un ami, c’est le même désir de s’échapper d’un monde privé d’empathie qui n’a plus rien à offrir que de sombres destins dans des paysages morts. Et la seule évasion possible se fera en direction d’un mythe au repos apaisant (le fameux éléphant du titre). S’attardant sur les gestes, les visages et les corps – au point de rendre leur environnement flou – la mise en scène s’enroule dans une succession de plans-séquences et d’analogies métaphoriques d’une beauté crépusculaire stupéfiantes. Collant au plus près des personnages, les effleurant de manière douce, la caméra colle parfois au ras-du-sol, glissant le long de l’asphalte d’une ville tentaculaire baignée d’une lumière spectrale et froide.
Cette grande tristesse, cette absence totale d’amour, qui imprègne le long-métrage de Hu Bo n’est, par ailleurs, sans doute pas étrangère à l’extrême souffrance intérieure de celui-ci (bien qu’il ne faille pas réduire les qualités esthétiques du premier à l’état dépressif du second). Le jeune réalisateur de 29 ans mis fin à ses jours quelques mois après la fin du tournage. Le réalisateur hongrois Béla Tarr disait de lui : « C’était un homme impatient, dans une urgence perpétuelle. Peut-être savait-il qu’il lui restait peu de temps… Il faisait tout pour obtenir sans attendre ce qu’il voulait. Il n’acceptait pas le monde, et le monde ne l’acceptait pas. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
17:09 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, dépression en basse altitude, an elephant sitting still, hu bo | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 06 décembre 2019
Ludovic Maubreuil : « Le cinéma européen a su parler des variations de l’âme féminine à travers le parcours d’actrices singulières »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Ludovic Maubreuil est critique et théoricien du cinéma. Il a notamment publié des essais aux éditions Alexipharmaque : « Le Cinéma ne se rend pas » (2008), « Bréviaire de cinéphilie dissidente » (2009), « Les images secondent » (2012), « Ciné-méta-graphiques » (2016), mais aussi un recueil de nouvelles « L’Égrégore rétinien » (Hypallage, 2015). Il vient de faire paraître « Cinématique des Muses » (Pierre-Guillaume de Roux, 2019), soit les portraits d’une vingtaine d’égéries énigmatiques et fascinantes qui, à travers leurs carrières composites, dévoilent une autre histoire du cinéma.
Le Comptoir : Ce qui étonne en ouvrant votre ouvrage c’est que vos « muses » ne sont pas des stars, des divas de renom, mais bien plutôt des comédiennes abonnées aux seconds rôles. Pourquoi un tel choix ? Chacune d’entre elles est-elle porteuse d’un cinéma qui lui est propre ?
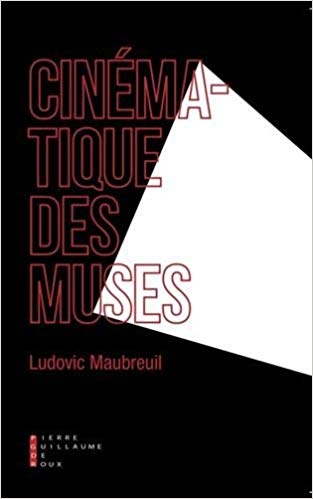 Ludovic Maubreuil : Si la plupart d’entre elles ont en effet été abonnées aux seconds rôles, quelques-unes ont eu droit aux premiers, mais pour des œuvres souvent mineures, tandis que d’autres se sont limitées aux personnages de troisième ordre, voire aux courtes apparitions. Je pense là tout particulièrement à Tina Aumont. Il y avait plusieurs raisons de privilégier ces actrices-là. D’abord parce qu’elles sont sinon méconnues du moins négligées. Si Catherine Jourdan ou Francine Bergé ne disent rien à beaucoup de spectateurs d’aujourd’hui, Amanda Langlet ou Cathy Rosier sont réduites à leur présence marquante, respectivement dans Pauline à la plage de Rohmer et Le Samouraï de Melville. Quant aux actrices comme Marie-France Pisier ou Claude Jade, qui ont en revanche beaucoup tourné, on croit les avoir si bien cernées qu’elles souffrent aujourd’hui d’un désintérêt certain. Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, « le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs ». Leur singularité splendide risque d’être recouverte par le charme commun des vedettes du moment, ou par la beauté immédiatement reconnaissable des comédiennes célèbres, laquelle, étalée aux yeux de tous, ne pose plus question.
Ludovic Maubreuil : Si la plupart d’entre elles ont en effet été abonnées aux seconds rôles, quelques-unes ont eu droit aux premiers, mais pour des œuvres souvent mineures, tandis que d’autres se sont limitées aux personnages de troisième ordre, voire aux courtes apparitions. Je pense là tout particulièrement à Tina Aumont. Il y avait plusieurs raisons de privilégier ces actrices-là. D’abord parce qu’elles sont sinon méconnues du moins négligées. Si Catherine Jourdan ou Francine Bergé ne disent rien à beaucoup de spectateurs d’aujourd’hui, Amanda Langlet ou Cathy Rosier sont réduites à leur présence marquante, respectivement dans Pauline à la plage de Rohmer et Le Samouraï de Melville. Quant aux actrices comme Marie-France Pisier ou Claude Jade, qui ont en revanche beaucoup tourné, on croit les avoir si bien cernées qu’elles souffrent aujourd’hui d’un désintérêt certain. Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, « le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs ». Leur singularité splendide risque d’être recouverte par le charme commun des vedettes du moment, ou par la beauté immédiatement reconnaissable des comédiennes célèbres, laquelle, étalée aux yeux de tous, ne pose plus question.
La différence qu’incarnent ces actrices ne sera bientôt plus comprise que comme une aimable coquetterie, un particularisme pour esthètes, une somme de détails désuets, alors qu’elle s’avère, et c’est la deuxième raison de ce choix, la plus solide contradiction à ce que le cinéma contemporain entérine comme image incontestable de la féminité. Enfin, je voulais raviver le souvenir de ces actrices du monde d’avant, leur rendre hommage non seulement en raison de l’effacement qui les guette, mais aussi parce qu’elles me semblent toutes porteuses d’une spécificité : chacune d’entre elles a en effet poursuivi de films en films, un récit particulier et c’est à ce spectacle qu’elles nous ont conviés.
« Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, "le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs". »
mardi, 26 novembre 2019
Crise sociale, remède littéraire : Revue Zone Critique #1
 Après sept années d’existence en ligne, la revue Zone Critique sort son premier numéro papier dont le thème principal – et très actuel – est la crise sociale. Servie dans un écrin du plus bel effet (la mise en page, la typographie, les illustrations : tout est d’une grande finesse), la revue accorde une large place à la réflexion littéraire mais aussi à l’analyse cinématographique avec notamment des portraits de Bong Joon-ho et sa « révolte biologique » des prolétaires, Ken Loach et sa dénonciation du libéralisme économique, Lee Chang-Dong et son « thriller poétique » Burning. Mais l’on parcourt aussi la rugosité des paysages dans le cinéma de Bruno Dumont et des frères Dardennes, la sublimation du réel chez Godard ou les apories du capitalisme dans la saga Alien.
Après sept années d’existence en ligne, la revue Zone Critique sort son premier numéro papier dont le thème principal – et très actuel – est la crise sociale. Servie dans un écrin du plus bel effet (la mise en page, la typographie, les illustrations : tout est d’une grande finesse), la revue accorde une large place à la réflexion littéraire mais aussi à l’analyse cinématographique avec notamment des portraits de Bong Joon-ho et sa « révolte biologique » des prolétaires, Ken Loach et sa dénonciation du libéralisme économique, Lee Chang-Dong et son « thriller poétique » Burning. Mais l’on parcourt aussi la rugosité des paysages dans le cinéma de Bruno Dumont et des frères Dardennes, la sublimation du réel chez Godard ou les apories du capitalisme dans la saga Alien.
Côté littérature, on apprend notamment que Les Misérables de Victor Hugo est l’antithèse du roman social ; ainsi que la différence entre un roman militant (un discours univoque calqué sur une intrigue manichéenne, à l’instar des Renards pâles de Yannick Haenel) et un roman politique (saisissant la complexité des personnages, leurs contradictions, introduisant nuance et précision, comme chez Arno Bertina ou François Bégaudeau). Ce dernier, dans un long entretien, assume « la beauté et la puissance de la pensée radicale », tandis que Marion Messina appel à retrouver le sens de la beauté et de l’universel en littérature contre les « petites ambitions » de l’autofiction.
On y trouve également un portrait de Houellebecq en lyrique contrarié dont l’œuvre « cartographie un monde déstructuré par l’économie de marché, par la libéralisation des corps et la fragmentation du lien social » ; une analyse de l’écriture à contre-courant de l’aliénation moderne de Marc-Emile Thinez et une exégèse de la « langue virevoltante » et politique d’Alain Damasio. Céline, en « diagnosticien du social », dynamitant la langue et incorporant dans « l’écriture la rage des victimes modestes », fait face à Steinbeck et son « humanisme compassionnel », sa « pitié grandiloquent », ses grands principes et ses bons sentiments en somme. Enfin, quelques écrivains, poètes et essayistes répondent chacun à leur manière à la question d’Hölderlin : « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:13 Publié dans Cinéma, Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, crise sociale, remède littéraire, revue zone critique #1, ken loach, françois bégaudeau, arno bertina, bong joon-ho, alain damasio | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 17 novembre 2019
Carole Talon-Hugon : « Une œuvre peut être admirable en dépit d’un défaut éthique »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Carole Talon-Hugon est philosophe, spécialiste d’esthétique, de philosophie de l’art et de théories des émotions. Directrice de publication de la Nouvelle revue d’esthétique et directrice de rédaction de la revue Noesis elle a notamment rédigé « Une histoire personnelle et philosophique des arts » en quatre volumes. Elle vient de publier « L’Art sous contrôle » (PUF), un essai court et documenté qui analyse la nouvelle injonction moralisatrice, se déployant de manière intégriste dans le monde de la culture, à l’aune du « nouvel agenda sociétal » et des « censures militantes ».
Le Comptoir : Ces dernières années, on voit surgir de plus en plus de demandes de boycott de tel film ou de tel réalisateur, de destruction de peintures ou de décrochage photos, de protestation contre des rétrospectives, de censure envers des installations, de pétition contre tel artiste, etc. au nom des combats sociétaux de l’époque (féminisme, combat LGBT, écologie, lutte postcoloniale…). Il semble pourtant qu’une grande partie des artistes d’aujourd’hui se revendiquent de ces engagements. Pourquoi une telle confrontation ?
 Carole Talon-Hugon : Il s’agit là de deux aspects du moralisme ambiant dans lequel se trouvent actuellement plongés les mondes de l’art : d’un côté des artistes affichant l’engagement de leurs œuvres dans des causes sociétales, de l’autre, des critiques militantes émanant des communautés réunies autour de ces mêmes causes, et visant des œuvres qu’elles jugent offensantes. Il y a moins là une contradiction que le recto et le verso d’une même pièce, les œuvres visées par la censure militante n’étant pas celles produites par l’art sociétal. Mais paradoxalement, il arrive que des œuvres affichant des intentions sociétales soient elles-mêmes contestées ; c’est par exemple le cas de la pièce Kanata de Robert Lepage, qui met en scène les Amérindiens du Québec et qui s’est vue accusée d’appropriation culturelle par les descendants de ceux-ci au motif que les rôles d’Amérindiens n’étaient pas jouées par des Amérindiens ; ou bien encore le cas de Scarlett Johansson qui a dû renoncer à jouer le rôle d’un transgenre après qu’on lui a reproché de n’en être pas un.
Carole Talon-Hugon : Il s’agit là de deux aspects du moralisme ambiant dans lequel se trouvent actuellement plongés les mondes de l’art : d’un côté des artistes affichant l’engagement de leurs œuvres dans des causes sociétales, de l’autre, des critiques militantes émanant des communautés réunies autour de ces mêmes causes, et visant des œuvres qu’elles jugent offensantes. Il y a moins là une contradiction que le recto et le verso d’une même pièce, les œuvres visées par la censure militante n’étant pas celles produites par l’art sociétal. Mais paradoxalement, il arrive que des œuvres affichant des intentions sociétales soient elles-mêmes contestées ; c’est par exemple le cas de la pièce Kanata de Robert Lepage, qui met en scène les Amérindiens du Québec et qui s’est vue accusée d’appropriation culturelle par les descendants de ceux-ci au motif que les rôles d’Amérindiens n’étaient pas jouées par des Amérindiens ; ou bien encore le cas de Scarlett Johansson qui a dû renoncer à jouer le rôle d’un transgenre après qu’on lui a reproché de n’en être pas un.
21:24 Publié dans Littérature, Politique | Tags : carole talon-hugon, le comptoir, sl'art sous contrôle, censure, féminisme, injonction moralisatrice, ylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)









